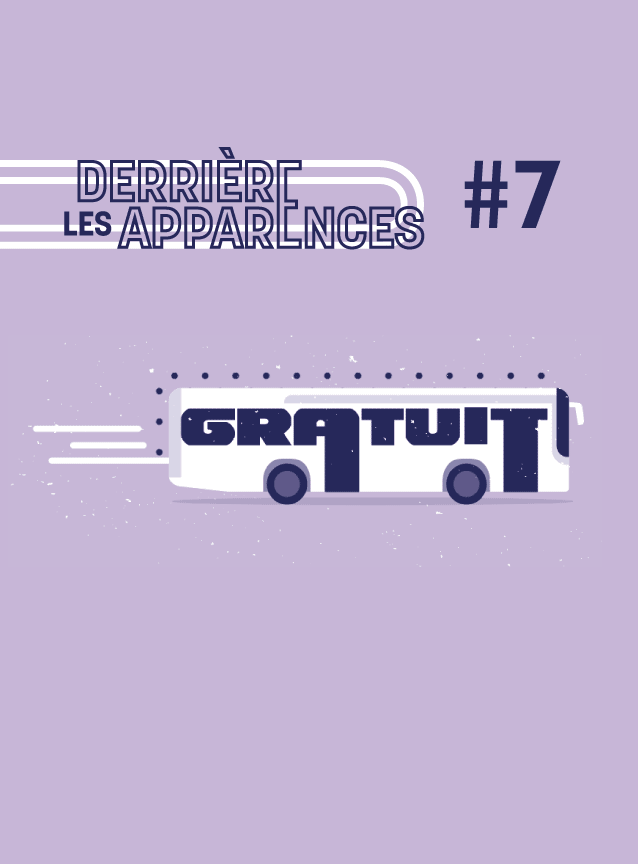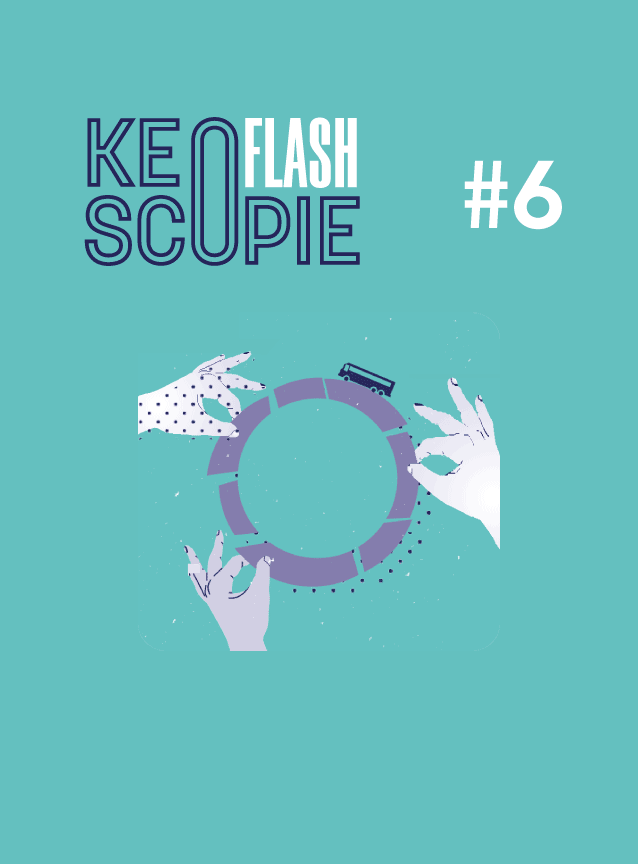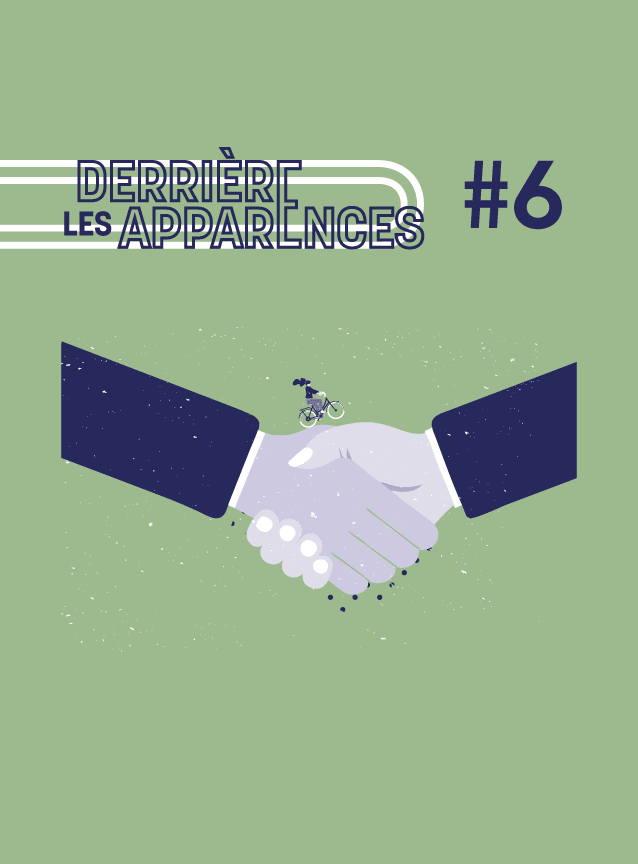Le transport représente plus d’un tiers des émissions de CO2 à l'échelle nationale, plaçant ce secteur au cœur des politiques de décarbonation des collectivités territoriales.[1] L'évolution des flottes de bus urbains illustre cette dynamique : en 2023, les véhicules à énergie thermique diesel en circulation sont passés pour la première fois sous la barre des 50 %, tandis que la part de ceux à énergie électrique bondissait de 3,9 % à 7,8 % en deux ans seulement. Pourtant, cette transition s'accompagne d'un paradoxe économique. « Un véhicule électrique coûte environ deux fois plus cher qu'un bus thermique », ce qui augmente fortement son coût total de possession, malgré une énergie et une maintenance moins coûteuses, explique Annelise Avril. Cette équation budgétaire complexe intervient précisément au moment où le règlement européen de juin 2024 impose aux collectivités et constructeurs d'atteindre 100 % de bus urbains neufs à très faibles émissions d'ici à 2035[2].
Transports publics : la gestion patrimoniale, clé de voûte de la décarbonation

Un triptyque de défis patrimoniaux
Les collectivités naviguent désormais entre trois impératifs difficiles à concilier. D'abord, développer l'offre de transports en commun pour répondre aux zones peu ou non desservies – condition sine qua non pour convaincre les automobilistes d'abandonner leur véhicule individuel. Ensuite, renouveler un parc vieillissant avec des technologies plus sobres en carbone mais plus onéreuses. Enfin, désaturer des réseaux de transport conçus il y a quinze à trente ans, qui atteignent aujourd’hui leurs limites capacitaires.
Cette convergence de contraintes incite les acteurs à se tourner vers des solutions d'une créativité remarquable. À Bordeaux, Keolis expérimente le fait de prolonger la durée de vie des rames de tramway de dix ans (pour passer de 30 à 40 ans). L'opération s'appuie sur des analyses approfondies de l’état et du vieillissement des rames bordelaises – exposition aux vibrations selon les conditions de roulage, niveau de corrosion observé – menées par des tiers indépendants. « Ces études nous ont permis de déposer un dossier de sécurité auprès de l’autorité compétente (STRMTG) détaille Annelise Avril. Cette approche robuste et exhaustive les a convaincus d'autoriser cette prolongation. » L'opération, d'une ampleur inédite, concerne 62 des 130 rames du réseau bordelais. Économiquement, la démonstration s'avère éloquente : là où une rame neuve représente un investissement de 6 millions d'euros, la remise à neuf complète coûte 600 000 euros – générant une économie supérieure à 80 millions d'euros sur l'ensemble du programme.
Certaines collectivités optent pour des stratégies collaboratives d'achat. Besançon, Brest et Toulouse ont ainsi mutualisé leur commande de rames neuves, bénéficiant de tarifs préférentiels grâce à des standards techniques harmonisés – défi complexe compte tenu des spécificités propres à chaque réseau.
L'intelligence de la désaturation
Les stratégies de désaturation révèlent une sophistication croissante des approches patrimoniales. À Dijon, cinq points névralgiques du réseau ont été réaménagés pour créer des terminus partiels, permettant d’accroître la fréquence de passage sur les tronçons les plus chargés sans mobiliser de matériel supplémentaire.
À Bordeaux, l'enjeu portait sur la fluidification des échanges entre les rives. « Les travaux menés cet été ont permis d'augmenter de 30 % les traversées du pont de Pierre, principal point de franchissement du tramway, grâce à de nouveaux aiguillages et la création d’itinéraires directs » précise Annelise Avril.
D'autres solutions ne nécessitent aucun investissement matériel. À Rennes, une collaboration avec le Bureau des Temps de la Métropole et l'Université a permis de décaler les horaires de cours de quinze minutes pour une partie des étudiants, lissant l'hyperpointe matinale et générant ainsi une baisse de 14 % de la charge sur la ligne A du métro desservant l'Université de Rennes 1. Reproduite cette année sur quatre établissements secondaires[3], cette méthode illustre comment une coordination intelligente permet de désaturer le réseau sans pour autant réaliser des investissements lourds.
L'émergence d'un écosystème technologique
L'électrification massive des bus transforme fondamentalement l'écosystème industriel du transport public. « Nous travaillons désormais avec des constructeurs spécialisés dans les infrastructures de charge, les fabricants de batteries, analyse Annelise Avril, créant un paysage d'acteurs beaucoup plus diversifié qu'avec les bus thermiques ». Cette nouvelle donne fait émerger de nouveaux métiers et redéfinit les compétences existantes. Les équipes de maintenance doivent maîtriser l'électrotechnique, gérer des systèmes de charge complexes, anticiper le vieillissement de batteries. Les planificateurs intègrent désormais les contraintes d'autonomie et les temps de recharge dans leurs calculs d'exploitation.
Ainsi, Keolis suit, en partenariat avec Forsee Power et Iveco France, le vieillissement accéléré des batteries, objectivant les conditions optimales de préservation de l'autonomie. « Ces analyses visent à établir des consignes opérationnelles permettant potentiellement d'étendre la durée de vie de plusieurs années», explique Annelise Avril. Une perspective qui pourrait bouleverser le modèle économique du transport électrifié.
Face au surcoût important des véhicules neufs électriques, une autre voie émerge : le rétrofit – conversion de véhicules thermiques existants vers l'électrique ou l'hydrogène. « Chaque situation nécessite une analyse spécifique comparant le TCO du véhicule rétrofité versus neuf », souligne Annelise Avril. À Clermont-Ferrand, cette stratégie prend forme concrètement : sept autocars rétrofités à l'hydrogène par GCK Mobility circulent – les moteurs thermiques originaux remplacés par des systèmes électriques alimentés par pile à combustible à hydrogène[4].
Vers une approche systémique
L'évolution rapide du paysage technologique impose aux collectivités une approche prudente. L'exclusion programmée du biogaz par le règlement européen va ainsi contraindre de nombreux territoires ayant massivement investi dans cette filière à revoir leurs stratégies vers l'électrique. « Ce serait une erreur de figer son choix de manière trop exclusive, même si l'électrique demeure incontournable. », prévient la Directrice Générale, Grand Réseaux Urbains de Keolis.
Mais cette transition se heurte à l'instabilité des mécanismes de financement. Les dispositifs actuels – guichet de l’ADEME soumis à reconduction annuelle, certificats d'économie d'énergie sans garantie de pérennité – offrent une visibilité de deux à trois ans. Une temporalité incompatible avec les planifications de parc qui s'étalent sur quinze ans. « Il faut donner aux territoires les moyens de se projeter sereinement sur leurs plans de parc », insiste Annelise Avril.
Cette mutation des pratiques patrimoniales appelle désormais un accompagnement public à la hauteur des enjeux. Car si les collectivités font preuve d'une remarquable créativité, elles ne pourront pas porter seules le poids de la transition énergétique des transports publics.
[1] Notre-environnement.gouv.fr
[2] Journal officiel de l’Union européenne
[4] Keolis.com
Ces articles peuvent vous intéresser